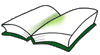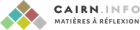Mots clés
 > CS : ENVIRONNEMENT SOCIAL ET LIEN SOCIAL > LIEN SOCIAL > ISOLEMENT > CS : ENVIRONNEMENT SOCIAL ET LIEN SOCIAL > LIEN SOCIAL > ISOLEMENT
ISOLEMENTSynonyme(s)solitude isolement social |
Documents disponibles dans cette catégorie (3)


 Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la rechercheIsolement et contention en psychiatrie en 2022 : un panorama inédit de la population concernée et des disparités d’usage entre établissements / Esther TOUITOU-BURCKARD (février 2024)


Titre : Isolement et contention en psychiatrie en 2022 : un panorama inédit de la population concernée et des disparités d’usage entre établissements Type de document : Ouvrage Auteurs : Esther TOUITOU-BURCKARD ; Coralie GANDRE ; Sébastien SAETTA Editeur : Institut de recherche et documentation en economie de la santé (IRDES) Année de publication : février 2024 Importance : 8 p. Note générale : Contribution à cet article par une partie des membres d'ENSEIS Recherche Langues : Français (fre) Mots clés : CONTENTION / ISOLEMENT / PRATIQUE PROFESSIONNELLE / PSYCHIATRIE / SANTE MENTALE / SOIN / TRAITEMENT STATISTIQUE Résumé : "L’isolement et la contention en psychiatrie constituent des pratiques de dernier recours destinées à répondre à des situations de crise et ne devant être mises en œuvre qu’à titre exceptionnel, en
accord avec les recommandations de bonnes pratiques. En France, la réduction de leur usage, inscrite à l’agenda politique international, figure parmi les objectifs de la Feuille de route ministérielle santé mentale et psychiatrie lancée en 2018 et s’appuie sur un nouveau cadre législatif à visée dissuasive. Dans ce contexte, cette étude fournit des données récentes sur le recours aux mesures d’isolement et de contention mécanique en psychiatrie à l’échelle nationale, et propose un panorama inédit de la population concernée ainsi que des variations du recours à ces mesures entre établissements de santé, en amont d’une deuxième étude qui visera à en caractériser les déterminants. En 2022, 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie : 37 % sont concernées par un recours à l’isolement, soit 28 000 personnes, et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. L’emploi de ces mesures varie de façon marquée entre les établissements, certains d’entre eux n’en faisant aucun usage. L’ampleur des variations suggère qu’elles ne peuvent être justifiées par des différences de besoins des populations prises en charge et soulève des interrogations en lien avec les enjeux éthiques et juridiques associés à l’usage de l’isolement et de la contention. Des éclairages qualitatifs permettent de repérer l’existence de savoirs, de pratiques et de représentations portés par une organisation du travail, une politique de ressources humaines et l’affirmation de valeurs, favorisant un moindre usage des pratiques coercitives en psychiatrie. Des politiques publiques plus ambitieuses, soutenant les équipes soignantes dans la limitation de l’usage des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie, demeurent à penser pour atteindre tous les établissements."(abstract étude)Note de contenu : "Il s’agit de la première exploitation des données nationales issues d’un registre établi en 2018 dans les établissements psychiatriques et visant à mesurer le recours à l’isolement et la contention. Il s’agit donc de résultats inédits qui permettent de constater, sur le territoire national, tant la fréquence du recours à ces mesures que de très importantes disparités (avec des établissements ayant un recours nul versus des établissements qui présentent des taux très élevés). " (Sébastien SAETTA) Complément : bibliographie En ligne : https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/286-isolement-et [...] Isolement et contention en psychiatrie en 2022 : un panorama inédit de la population concernée et des disparités d’usage entre établissements [Ouvrage] / Esther TOUITOU-BURCKARD ; Coralie GANDRE ; Sébastien SAETTA . - Institut de recherche et documentation en economie de la santé (IRDES), février 2024 . - 8 p.
Contribution à cet article par une partie des membres d'ENSEIS Recherche
Langues : Français (fre)
Mots clés : CONTENTION / ISOLEMENT / PRATIQUE PROFESSIONNELLE / PSYCHIATRIE / SANTE MENTALE / SOIN / TRAITEMENT STATISTIQUE Résumé : "L’isolement et la contention en psychiatrie constituent des pratiques de dernier recours destinées à répondre à des situations de crise et ne devant être mises en œuvre qu’à titre exceptionnel, en
accord avec les recommandations de bonnes pratiques. En France, la réduction de leur usage, inscrite à l’agenda politique international, figure parmi les objectifs de la Feuille de route ministérielle santé mentale et psychiatrie lancée en 2018 et s’appuie sur un nouveau cadre législatif à visée dissuasive. Dans ce contexte, cette étude fournit des données récentes sur le recours aux mesures d’isolement et de contention mécanique en psychiatrie à l’échelle nationale, et propose un panorama inédit de la population concernée ainsi que des variations du recours à ces mesures entre établissements de santé, en amont d’une deuxième étude qui visera à en caractériser les déterminants. En 2022, 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie : 37 % sont concernées par un recours à l’isolement, soit 28 000 personnes, et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. L’emploi de ces mesures varie de façon marquée entre les établissements, certains d’entre eux n’en faisant aucun usage. L’ampleur des variations suggère qu’elles ne peuvent être justifiées par des différences de besoins des populations prises en charge et soulève des interrogations en lien avec les enjeux éthiques et juridiques associés à l’usage de l’isolement et de la contention. Des éclairages qualitatifs permettent de repérer l’existence de savoirs, de pratiques et de représentations portés par une organisation du travail, une politique de ressources humaines et l’affirmation de valeurs, favorisant un moindre usage des pratiques coercitives en psychiatrie. Des politiques publiques plus ambitieuses, soutenant les équipes soignantes dans la limitation de l’usage des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie, demeurent à penser pour atteindre tous les établissements."(abstract étude)Note de contenu : "Il s’agit de la première exploitation des données nationales issues d’un registre établi en 2018 dans les établissements psychiatriques et visant à mesurer le recours à l’isolement et la contention. Il s’agit donc de résultats inédits qui permettent de constater, sur le territoire national, tant la fréquence du recours à ces mesures que de très importantes disparités (avec des établissements ayant un recours nul versus des établissements qui présentent des taux très élevés). " (Sébastien SAETTA) Complément : bibliographie En ligne : https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/286-isolement-et [...] Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

Isolement et contention en psychiatrie en 2022URLPLAID-Care Psychiatrie et libertés individuelles : étude d’établissements caractérisés par un moindre recours à la coercition / Sébastien SAETTA (2024)


Titre : PLAID-Care Psychiatrie et libertés individuelles : étude d’établissements caractérisés par un moindre recours à la coercition : rapport final de recherche Type de document : Ouvrage Auteurs : Sébastien SAETTA ; Magali COLDEFY ; Coralie GANDRE ; Jean-Paul LANQUETIN ; Delphine MOREAU ; Frédéric MOUGEOT ; Yvonne QUENUM ; Loïc ROHR ; Livia VELPRY Editeur : Paris : Institut pour la Recherche en Santé Publique (IRESP) Année de publication : 2024 Importance : 61 p. Langues : Français (fre) Mots clés : CONTENTION / ISOLEMENT / PRATIQUE PROFESSIONNELLE / PSYCHIATRIE Index. décimale : H47 Santé mentale - Psychiatrie Résumé : "La fréquence et les importantes disparités en matière de recours à la coercition, notamment à l’isolement et à la contention sur le territoire français, ont été confirmées. Si les établissements peu coercitifs sont minoritaires, la moindre coercition n’est pas pour autant anecdotique, avec notamment environ 10% d’établissement déclarant ne pas recourir à la contention. Les tâches 2 et 3 ont permis de mettre en exergue trois catégories de leviers de la moindre coercition (relation de soin, collectif de soin, milieu de vie) qui sont soutenus par une culture du soin et dont l’activation et la pérennité sont liées au travail de l’équipe d’encadrement, à une communauté médicale impliquée et soudée, au soutien des directions, ainsi qu’à une culture d’établissement et à des processus d’institutionnalisation."
(extrait du résumé du rapport)Note de contenu : Recherche conduite par le Laboratoire de recherche ENSEIS, dans le cadre de l'AAP de Recherche en santé publique 2020
« Interventions, services et politiques favorables à la santé »Complément : bibliographie/graphiques/Photographies En ligne : https://recherche.enseis.fr/travaux-de-recherche/sante-handicap-et-dependance/ps [...] PLAID-Care Psychiatrie et libertés individuelles : étude d’établissements caractérisés par un moindre recours à la coercition : rapport final de recherche [Ouvrage] / Sébastien SAETTA ; Magali COLDEFY ; Coralie GANDRE ; Jean-Paul LANQUETIN ; Delphine MOREAU ; Frédéric MOUGEOT ; Yvonne QUENUM ; Loïc ROHR ; Livia VELPRY . - Paris : Institut pour la Recherche en Santé Publique (IRESP), 2024 . - 61 p.
Langues : Français (fre)
Mots clés : CONTENTION / ISOLEMENT / PRATIQUE PROFESSIONNELLE / PSYCHIATRIE Index. décimale : H47 Santé mentale - Psychiatrie Résumé : "La fréquence et les importantes disparités en matière de recours à la coercition, notamment à l’isolement et à la contention sur le territoire français, ont été confirmées. Si les établissements peu coercitifs sont minoritaires, la moindre coercition n’est pas pour autant anecdotique, avec notamment environ 10% d’établissement déclarant ne pas recourir à la contention. Les tâches 2 et 3 ont permis de mettre en exergue trois catégories de leviers de la moindre coercition (relation de soin, collectif de soin, milieu de vie) qui sont soutenus par une culture du soin et dont l’activation et la pérennité sont liées au travail de l’équipe d’encadrement, à une communauté médicale impliquée et soudée, au soutien des directions, ainsi qu’à une culture d’établissement et à des processus d’institutionnalisation."
(extrait du résumé du rapport)Note de contenu : Recherche conduite par le Laboratoire de recherche ENSEIS, dans le cadre de l'AAP de Recherche en santé publique 2020
« Interventions, services et politiques favorables à la santé »Complément : bibliographie/graphiques/Photographies En ligne : https://recherche.enseis.fr/travaux-de-recherche/sante-handicap-et-dependance/ps [...] Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112506 H47-SAE Livre Firminy Ouvrage Disponible Documents numériques

Rapport_scientifique_final_PLAID-CareAdobe Acrobat PDF
Titre : Les violences inaudibles : Récits d'infanticides Type de document : Ouvrage Auteurs : Julie ANCIAN Editeur : Paris : Seuil Année de publication : 2022 Collection : La couleur des idées Importance : 278 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-02-146572-3 Langues : Français (fre) Mots clés : ACCOUCHEMENT / AVORTEMENT SPONTANE / CRIME / FAMILLE / INEGALITE / INFANTICIDE / ISOLEMENT / LEGISLATION / NOURRISSON / PAUVRETE / RELATION ENFANT-MERE / RELATION ENFANT-PARENTS / VIOLENCE FAMILIALE Index. décimale : A65 Psychologie - Inadaptation sociale Résumé : "Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Les cas d'infanticides font régulièrement la une des médias. Dans une société qui idéalise la maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa naissance font figure de monstres ou de folles. Cet ouvrage, fruit d'une longue enquête en prison et en cours d'assises, montre à rebours qu'il s'agit de crimes liés au contrôle de la fertilité plutôt qu'à des problèmes de santé mentale. S'appuyant sur les témoignages exceptionnels de femmes condamnées pour ces faits, l'auteure propose en effet une autre lecture de ces homicides. Elle montre que ces crimes sont liés à des situations de grande détresse : pauvreté, violences conjugales, isolement, absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue en France, l'accès aux services de planning familial, à une contraception efficace ou à un avortement, n'est pas garanti pour toutes les femmes. L'observation de procès, des entretiens avec des professionnels de justice et l'analyse d'archives journalistiques viennent compléter l'enquête et examiner en miroir la manière dont la société perçoit et juge ces crimes. Face à ces situations de détresse, le traitement judiciaire apparaît aveugle aux inégalités sociales et particulièrement indulgent envers les hommes violents ou ceux qui se moquent de féconder leur partenaire sans leur consentement. L'institution judiciaire qui se caractérise par ses biais de genre et de classe, perpétue un discours trompeur sur la libre disposition de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Ainsi, loin de dépeindre des figures monstrueuses, cette recherche dénonce les violences encore inaudibles qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes."(4eme de couverture) Les violences inaudibles : Récits d'infanticides [Ouvrage] / Julie ANCIAN . - Paris : Seuil, 2022 . - 278 p.. - (La couleur des idées) .
ISBN : 978-2-02-146572-3
Langues : Français (fre)
Mots clés : ACCOUCHEMENT / AVORTEMENT SPONTANE / CRIME / FAMILLE / INEGALITE / INFANTICIDE / ISOLEMENT / LEGISLATION / NOURRISSON / PAUVRETE / RELATION ENFANT-MERE / RELATION ENFANT-PARENTS / VIOLENCE FAMILIALE Index. décimale : A65 Psychologie - Inadaptation sociale Résumé : "Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Les cas d'infanticides font régulièrement la une des médias. Dans une société qui idéalise la maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa naissance font figure de monstres ou de folles. Cet ouvrage, fruit d'une longue enquête en prison et en cours d'assises, montre à rebours qu'il s'agit de crimes liés au contrôle de la fertilité plutôt qu'à des problèmes de santé mentale. S'appuyant sur les témoignages exceptionnels de femmes condamnées pour ces faits, l'auteure propose en effet une autre lecture de ces homicides. Elle montre que ces crimes sont liés à des situations de grande détresse : pauvreté, violences conjugales, isolement, absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue en France, l'accès aux services de planning familial, à une contraception efficace ou à un avortement, n'est pas garanti pour toutes les femmes. L'observation de procès, des entretiens avec des professionnels de justice et l'analyse d'archives journalistiques viennent compléter l'enquête et examiner en miroir la manière dont la société perçoit et juge ces crimes. Face à ces situations de détresse, le traitement judiciaire apparaît aveugle aux inégalités sociales et particulièrement indulgent envers les hommes violents ou ceux qui se moquent de féconder leur partenaire sans leur consentement. L'institution judiciaire qui se caractérise par ses biais de genre et de classe, perpétue un discours trompeur sur la libre disposition de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Ainsi, loin de dépeindre des figures monstrueuses, cette recherche dénonce les violences encore inaudibles qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes."(4eme de couverture) Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 413197 A65-ANC Livre Bourg en Bresse Ouvrage Disponible